
Power and Governance
Shifting powers structures and increased skepticism is challenging institutions. How can the network continue to build trust against this backdrop?
The past decade has shown the fragility and inability of today’s global governance mechanisms, an interlocking system of competing sovereign states, international organizations like the UN, and non-state NGOs and corporations, to address adequately world issues such as climate change and environmental degradation. Many have observed that the scale and capacity of nation-states is insufficient for the problems facing the increasingly globalized world today, too big for local accountability and too small to deal with issues requiring global intervention. At the same time, forms of cross-border governance are changing and increasing in strength and effectiveness (the Chinese One Belt One Road Initiative, ASEAN, and the rise of regional free trade areas in West and East Africa are examples).
The private sector is also increasing in power and influence, potentially driving a trend for alternative forms of governance, with many companies wielding more influence on global issues than most countries, most recently recognized by the Danish Government appointing an ambassador to Silicon Valley. A few international humanitarian organizations have followed suit, with Amnesty International and UNICEF appointing representatives to the Silicon Valley to engage for influence and partnerships. The private sector, responding to an increasing consumer social consciousness, has also invested in areas of social impact that are usually seen as a ‘public responsibility’, and taken on increased roles in delivering humanitarian and development aid, further questioning the governance roles played by nation states and humanitarian organizations.
Increasingly, cities are also asserting their geopolitical power on the world stage, with megacities becoming powerful influencers by themselves. Greater city-level governance and pan-city networks have gained wider acceptance as another model of global governance. This view holds that cities are re-emerging as political forces on the world stage, able to address problems more nimbly at the local level and to network across national boundaries to face global challenges. Foreign direct investment is being injected into cities of emerging markets as the confluence of urbanization and a large youth workforce are seen as attractive investments.
Amongst the mosaic of newly forming pockets of power and influence, is the reality that trust in global institutions (including government and humanitarian organizations) is at an all-time low. The 2017 Edelman Trust Barometer paints a picture of a broken global system with little hope for things to improve. Humanitarian organizations are caught in this web of distrust – a long way from 2001 when they were considered a rising influence. 53% of global respondents showed trust in humanitarian organizations, a large decline from a peak of 66% trust in 2014. In the last year alone, high profile scandals involving corruption and sexual abuse have only heightened these levels of distrust, with the public and donors calling for new accountability measures and investigations.
This backdrop is contributing to fueling a rise of social movements and fringe groups, pushing back against issues of power and elitism. Enduring economic stagnation and increasing mistrust of politics are driving populism, nationalism, and cultural and religious clashes. It is indicative of increasing skepticism in government and bureaucracy among many democracies and youth especially. It would be a mistake however to overestimate the recent surge in nationalistic sentiment across Europe and North America, as deteriorating global crises and time itself may yet provide conditions for greater institutional enforcement and legal structures at the global level. At the same time, national governments in the global south are taking more assertive roles and questioning foreign involvement in domestic affairs.
If the trend toward heightened nationalism continues amidst a declining relevance of global governance (including declining significance of UN systems) and slow or non-existent intervention from global powers in crises, we could see national crises spiral significantly, or remain ignored or forgotten. Furthermore, restrictions to the delivery of aid from international organizations by states suspicious of foreign intervention, and their own gaps in domestic regulation and procedures necessary to manage outside aid, may exacerbate crises and lead to gaps in the coverage of needs.
Considerations and Tension Points for the Red Cross and Red Crescent
- As expectations change about how governments relate to their citizens, how are perceptions of National Societies – and of their auxiliary role – likely to change?
- How does the IFRC network engage with local governments and the private sector to develop new approaches to addressing humanitarian and development need? Are our efforts at advocacy, representation and partnerships reflective of shifting power structures?
- Are the structures of the IFRC member network and decision-making processes in line with broader social and political shifts? Are financial and organizational structures previously established to serve north to south flows suited to the shifting dynamics of global power and influence?
- How will RCRC engage with governance mechanisms and structures to ensure that support continues for low profile crises?
- With issues of credibility and trust deepening, how should the Secretariat and National Societies continue to build trust within this complex backdrop of significantly different constituencies – communities, donors, partners?
What are the possibilities?
The auxiliary role affords National Societies the opportunity to remain close to national governments. However, our trusted brand and unparalleled scale also affords access to the major private sector players and provides an opportunity to ‘bend the trillions’ in addition to ‘spending the billions’, if that trust can be maintained. An extensive infrastructure through the branch network ensures a foundation through which both citizen/community level and city level engagement can fruitfully deepen, but will require new models and thinking. The global network and representation through the IFRC and member National Societies gives the organization the potential to influence global forces while mobilizing effectively around a localization agenda.
Are there other elements to this trend that we should be considering?
How do you think it will affect vulnerability and the Red Cross and Red Crescent?
Leave your comments below
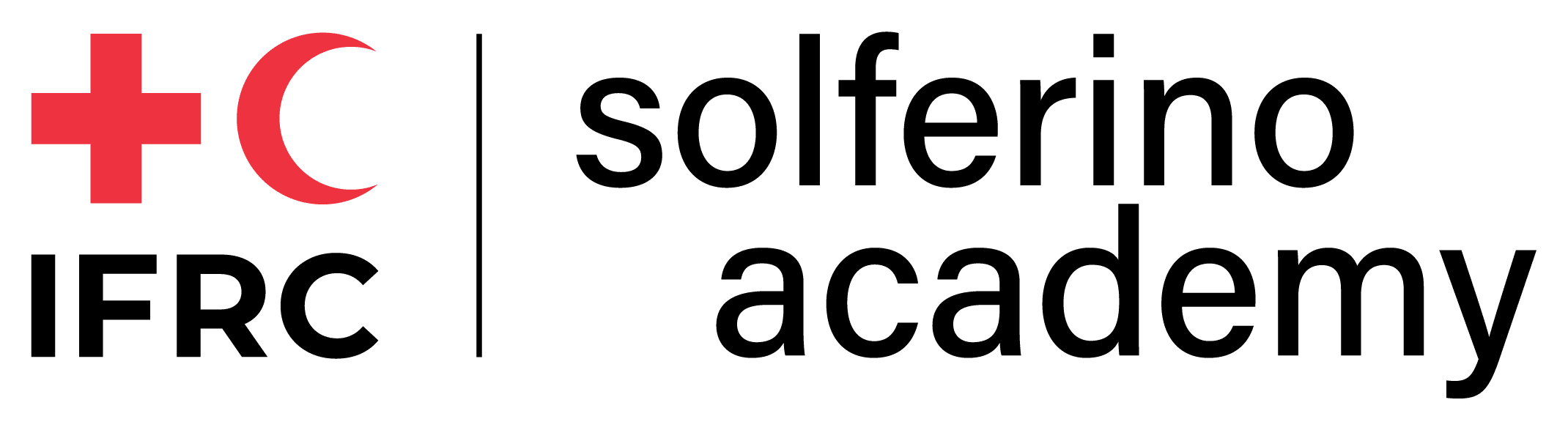

Le véritable problème du réseau des membres et des instances de la FICR réside d’abord au niveau des relations structurelles et décisionnelles entre les deux composantes des Sociétés Nationales surtout de l’Afrique où les membres de la gouvernance ne se limitent pas à leurs rôles. Très fréquemment ils interfèrent (volontairement ou involontairement) avec les activités de l’exécutif, plus précises et plus dynamiques. Ils faut aussi reconnaitre que les rôles qui les sont confiés sont des activités bénévoles, sans profits clairs et structurés, d’où la prise en otage par occasion des activités de l’exécutif du fait du pouvoir ultime qu’ils se sont donné eux-mêmes dans leurs textes. Compte tenu de l’excellence que requièrent les activités de la mission humanitaire de nos jours (professionnalisme exigé) la qualité des membres ne correspond pas généralement aux défis. La motivation des membres de la gouvernance se pose en Afrique, quoi qu’on dise. Je ne sais pas comment font les membres de la gouvernance des pays du Nord. Mais il faut voir la vérité en face et être pragmatique. Le travail qu’abattent aussi certains membres de la gouvernance est professionnel et mérite une motivation, un intéressement à moins que ces membres ne fasse plus le travail de contrôle, de suivi, de direction, de décision. Tant qu’une forme de motivation (surtout financière) n’est pas accordée aux membres de la gouvernance en Afrique, on n’ira pas loin avec la bonne gouvernance ni avec les résultats institutionnels. Généralement, aucun engagement de résultat ne lie les membres de la gouvernance lors de leur mandat en Afrique. Ils les sont attribué le pouvoir de décision sans aucun lien avec la compétence ni avec des obligations strictes ou codes de conduites à respecter et à suivre par un organe quelconque. Sur un autre plan, tant que la FICR ne s’intéresse pas à la qualité des documents de base des SN et adopte un modèle de suivi de la relation entre la gouvernance et l’exécutif la qualité médiocre du style de gouvernance perdurera. Vue simplement, la gouvernance n’est-elle pas cet ensemble de dispositions techniques et pratiques mis en place pour diriger une organisation ? Si oui pourquoi la FICR à l’image du fonctionnement de son secrétariat à Genève n’impose pas de léguer un pouvoir de décision à l’exécutif au niveau des SN en Afrique, lesquelles en majorité n’ont que le pouvoir de gestion assujetti au mot du Président ? On dira ici qu’il s’agit d’une question de souveraineté à respecter. Oui, mais on oubli que les documents qui régissent les Sociétés Nationales sont rédiger et approuvés par les membres de la gouvernance et que le personnel de l’exécutif est recruté, sans influence sur les orientations majeures. Quelque chose fonctionne mal à l’origine de la structure des Croix- Rouge/ Croissant- Rouge. On croira qu’on met en conflit dès à l’origine la gouvernance (qui décide sans maitrise du quotidien et sans revenu pécuniaire) et l’exécutif (qui met en œuvre avec une obligation de résultats et disposant de revenu pécuniaire). Cela engendre un conflit de jalousie due à la comparaison et à l’envie. Présentement en Afrique, en général le pouvoir décisionnel revient à la gouvernance et cela ne correspond plus au manque d’exigence de résultats à son égard. La qualité des résultats en souffre ainsi que la qualité de la communication amenant à transformer l’environnement de plusieurs Sociétés Nationales en un véritable champ de bataille ou de champs de conflits latents où prédomine parfois la chasse à l’homme.
Sur un autre registre, la FICR perd une grosse opportunité de capitalisation des expériences et des connaissances en ne mettant pas en place une espèce de « plan de carrière » (je pèse mon mot ici) ou une manière de faire profiter au Monde l’expertise développée par les Secrétaires Généraux. Je ne suis pas en train de défendre l’intérêt d’une corporation. Loin sans faut. Mais quand on constate en longueur de temps des personnes nouvellement venues qui enjambe les hautes sphères de la FICR et par ce truchement au gré du fait que leurs pays apportent le financement fait recruter des novices de la scène internationale. Je ne dis pas que tous les cas sont comme ça. Mais quelques parts la FICR investit dans la formation des Secrétaires Généraux par les nombreuses rencontres d’échanges et de formations thématiques. Oui on dira que c’est pour qu’ils servent leurs pays que cela est fait. On oubli pour autant qu’il faut un accompagnement structurel des Secrétaires Généraux des Sociétés Nationales afin qu’il soit dans son plein pouvoir de travail. Pourquoi après un certain temps les Secrétaires Généraux ne peuvent pas prétendre à des postes de la FICR pour partager ces connaissances à l’international ? La Fédération doit s’intéresser davantage à la gestion de la relation entre la gouvernance et l’exécutif dans les SNA en apportant un équilibre dans le pouvoir décisionnel? Ceci aura un impact certain sur la qualité et la célérité des activités de la mission humanitaire.
Dans le cadre de la coopération, le déploiement des délégués au niveau des Sociétés Nationales Africaines soulève un défi majeur tant au plan économique qu’au plan de l’équité. Les coûts de mobilisation des délégués étrangers en rapport avec les apports sont fortement déséquilibrés souvent. Par comparaison le personnel local qui joue d’ailleurs le premier rôle technique et qui au nom du principe de l’unité est le premier responsable des actions ne bénéficient pas en retour de motivation équitable. En réponse, on me dira que ce sont nos pays qui doivent nous mettre dans ces conditions de travail. Je dirai non. La mission humanitaire est universelle et le monde se globalise. On doit avoir le courage de reconnaitre que les fonds qui sont mobilisés le sont au nom des communautés de nos pays. Comme institution humanitaire, on doit innover et se rendre compte que les besoins financiers sont valables pour tout être vivant et d’ailleurs en terme de satisfaction de ces mêmes besoins, le fossé est très grand entre un employé du sud et celui du nord. On doit être à mesure d’amener un équilibre au sein du mouvement CRCR dont la vocation humanitaire doit reposer sur des bases de l’équité et de la globalisation. La présence de cadres intellectuels de plus en plus dans les SNA doit amener à réfléchir sur la mise en place d’un traitement universel des agents de la CRCR. C’est en cela que nous serons une institution mondiale. On doit donc passer de « mouvement mondial » à « institution mondiale ». Pour finir, le déploiement des délégués au niveau des Sociétés Nationales Africaines engendre l’assistanat et non un véritable partenariat. Il est tout a fait évident que le premier facteur de résolution de ce point est la proactivité que les SNA doivent faire montre face à leurs états (gouvernements). Ceci est un grand défi à relever sans l’aide de personne de l’extérieur. Une fois que les états jouent le premier rôle et que les SN soient reconnues davantage (pas en théorie, mais dans la pratique des faits concrets) il sera nécessaire de revoir le cadre de partenariat avec les États. Cet exercice est nécessaire aujourd’hui. Le principe d’indépendance n’est pas à révoquer, mais à accorder à la réalité des faits. L’état est le principal, la Croix- Rouge est l’auxiliaire. Les états trouvent que les SN sont éloignées de leur giron et celles ci ont peur de voir leurs actions cautionnées par les états. Il est nécessaire de trouver une médiane de ces deux pensées aujourd’hui.