Célébration des 60 ans des principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
En 1965, dans un contexte de divisions de la Guerre froide et de souvenirs hantés par deux guerres mondiales, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a codifié sept Principes Fondamentaux pour guider l’action humanitaire : Humanité, Impartialité, Neutralité, Indépendance, Volontariat, Unité et Universalité.

Ces principes étaient audacieux et visionnaires pour leur époque. Ils ont permis aux acteurs humanitaires de traverser les lignes de front, de préserver la dignité face aux catastrophes et de gagner la confiance des parties en conflit. Pendant six décennies, ils nous ont aidés à répondre à certaines des situations les plus complexes et déchirantes auxquelles l’humanité a été confrontée.
Mais le monde de 2025 n’est pas celui de 1965. Les crises d’aujourd’hui sont plus longues, plus profondes et plus interconnectées. Les conflits ne se terminent plus, ils se métastasent. Le dérèglement climatique redessine la carte de la vulnérabilité. Les pandémies, la montée de l’autoritarisme et les inégalités croissantes révèlent à quel point nos systèmes peuvent être fragiles.
Et au milieu de tout cela, la notion même d’humanitarisme est mise à l’épreuve par la récupération politique, le scepticisme du public et les limites de principes qui, bien que toujours vitaux, ne sont peut-être plus suffisants à eux seuls.
Alors, que manque-t-il ? Ma réponse est un nouveau principe – le principe de solidarité.

Des jeunes volontaires à Solwe et Mango Station, au Vanuatu, ont suivi une formation Y-Adapt pour mieux comprendre le changement climatique et agir dans leurs communautés. ©Nicky Kuautonga/FICR
Un principe enraciné dans notre passé et prêt pour notre avenir
La solidarité n’est pas une idée nouvelle. Elle est ancrée dans notre histoire, que ce soit chez les civils de Solferino qui ont aidé les blessés sans discrimination, ou dans les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui se sont soutenues mutuellement par-delà les frontières en temps de guerre, de catastrophe et de maladie. Nous avons toujours agi avec solidarité. Nous ne l’avons simplement jamais appelée un principe.
La solidarité nous invite à aller au-delà de l’apport de secours aux personnes pour cheminer avec elles – écouter, apprendre et agir ensemble. Elle redéfinit ceux que nous servons non pas comme des victimes, mais comme des partenaires. Elle remet en question les dichotomies donateur/bénéficiaire, aidant/aidé, Nord global/Sud global. Elle nous permet de reconnaître que la souffrance, où qu’elle soit, est liée à des décisions, des politiques et de l’indifférence ailleurs.
De nombreux penseurs éminents ont appelé à la solidarité comme principe éthique central en ce siècle. Hannah Arendt voyait la solidarité comme l’antidote au détachement moral. Le Pape François a présenté la solidarité non pas comme de la charité, mais comme « une attitude sociale née d’une conversion personnelle », enracinée dans le bien commun. Judith Butler parle de la solidarité comme de la reconnaissance de notre précarité partagée, tandis que des théoriciens politiques comme Iris Marion Young soutiennent que la justice mondiale est impossible sans un engagement envers la responsabilité partagée.
Dans le monde humanitaire, des chercheurs comme Hugo Slim ont averti que la neutralité, autrefois indispensable, peut désormais risquer l’anesthésie morale face à l’injustice. David Rieff est allé plus loin, critiquant le malaise du système d’aide face à la réalité politique et son repli dans une neutralité technocratique.
La solidarité, dans ce contexte, n’est pas un abandon de nos principes – c’est leur évolution. Elle aide à garantir que l’humanité ne se réduise pas à la pitié, que la neutralité ne devienne pas de l’indifférence, et que l’indépendance ne justifie pas le silence.

Faisant preuve de solidarité lors des incendies de forêt de Lattaquié en juillet 2025, les volontaires du Croissant-Rouge arabe syrien ont rapidement soutenu les évacuations, les évaluations des besoins et les soins médicaux urgents. ©Croissant-Rouge arabe syrien
Du concept à l’engagement
Nous voyons la solidarité en action chaque jour. Chez les volontaires qui continuent de servir à Gaza, en Ukraine, au Soudan et au Myanmar – souvent après avoir tout perdu eux-mêmes.
Dans les Sociétés nationales qui se mobilisent pour aider leurs voisins même lorsqu’elles font face à leurs propres crises.
Chez les jeunes qui exigent la justice climatique au-delà des frontières.
Dans les communautés de la diaspora qui organisent des secours plus rapidement que les systèmes formels ne le pourraient jamais.
Mais la solidarité est plus qu’une action. C’est un état d’esprit. Une éthique. Un principe.
Adopter la solidarité comme principe signifierait :
- Reconnaître que les besoins humanitaires sont souvent des symptômes d’injustices plus profondes.
- Être plus audacieux dans notre voix publique lorsque l’humanité est attaquée.
- Abandonner l’illusion de neutralité lorsqu’elle ne sert qu’à nous protéger de vérités inconfortables.
- Rééquilibrer le pouvoir au sein du secteur humanitaire afin que la prise de décision, les ressources et la visibilité soient partagées plus équitablement.
Cela signifie également rejeter l’idée que se tenir aux côtés des gens est en quelque sorte moins neutre que de se tenir à côté d’eux en silence.
Chaque principe que nous chérissons est né d’une rupture. Les Conventions de Genève sont nées des horreurs de la guerre du 19e siècle. Les Principes Fondamentaux sont nés des décombres du conflit mondial et de la montée des divisions idéologiques.
Nous sommes maintenant dans une autre rupture – une qui remet en question les fondements mêmes, moraux et opérationnels, de notre travail humanitaire.
Soixante ans après l’adoption des Principes Fondamentaux, ne nous contentons pas de les honorer, mais élargissons-les.
La solidarité a toujours été présente dans nos actions. Peut-être est-il temps d’en faire un principe.
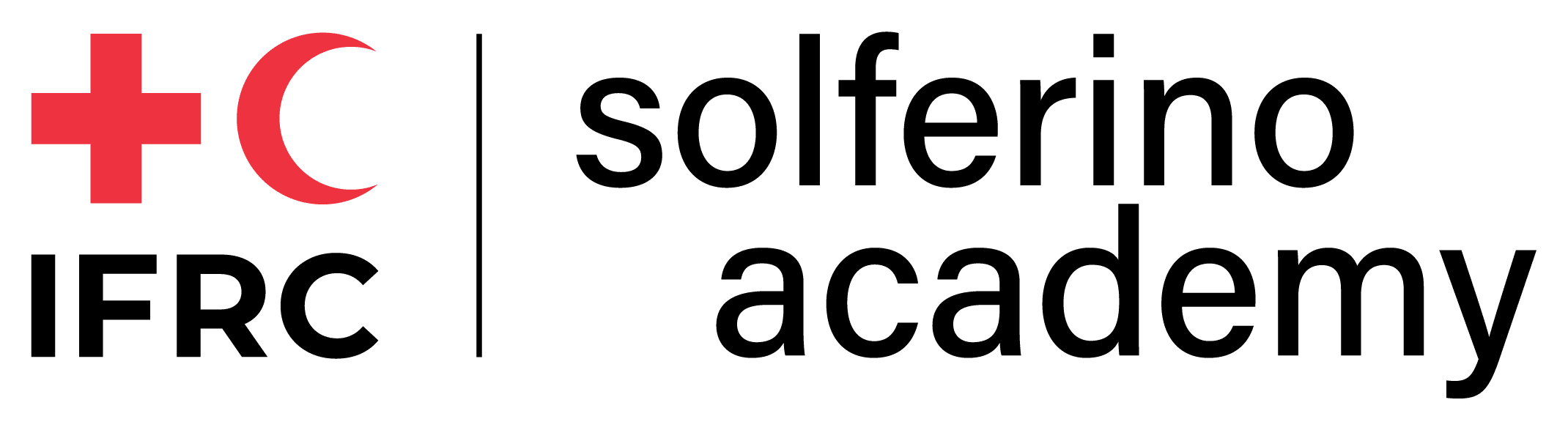
0 commentaires